 |
| La Galerie des Miroirs |
Regardez bien ce tableau. Oui, regardez-le bien.
Je crois qu'on a rarement réussi à évoquer avec plus de force la solitude du pouvoir ou tout simplement la solitude d'un homme que dans ce tableau du grand peintre iranien Mohammad Ghaffari, de son nom d'artiste Kamal ol-Molk (m. en 1941).
On distingue vaguement au loin la figure du souverain d'Iran, Nasseredine Shah, minuscule, perdue au milieu de cette immense Galerie des Miroirs, totalement déserte, de son palais du Golestan (la Roseraie). L'artiste nous décrit avec une minutie et une maîtrise technique confondante, les dorures, les tapis précieux, les rideaux en mousseline, les lustres gigantesques, l'alignement des fauteuils vides et surtout ces innombrables miroirs dont les murs et les plafonds sont tapissés et qui amplifient le luxe - on serait tenté de dire le clinquant - de ce décor somptueux en le réfléchissant et en le multipliant à l'infini. Une merveilleurse lumière aux teintes dorée et rose baigne l'atmosphère. Même le soleil, entrant à grands flots par les immenses fenêtres, semble s'est mis de la partie pour conférer à cette Galerie des Miroirs un éclat encore plus somptueux.
Pourtant, le Shah, semble indifférent à tout ce faste. Il lui tourne même le dos. Assis dans un fauteuil, immobile, perdu dans ses pensées, il regarde à l'extérieur par les baies vitrées. On aperçoit, entre les rideaux, la nature que l'on devine belle en ce beau jour ensoleillé et qui est réduite ici à sa portion congrue. A quoi pense le roi ? A quoi rêve t-il ? Depuis combien de temps est-il là ? Il semble plus triste que heureux, en tout cas profondément seul. Une mélancolie poignante se dégage de cette silhouette assise telle une ombre.
Pauvre Naseredine Shah ! Lui qui a fait bâtir cette Galerie des Miroirs à sa gloire pour épater le tout Téhéran et les ambassadeurs du monde entier. Lui qui, lors d'une visite à l'école d'art de Téhéran a tenu à rencontrer Mohamed Ghaffari, ce jeune prodige qui peint à la manière occidentale. Il a été tellement impressionné par le jeune artiste qu'il l'a invité à venir s'installer à sa cour, en a fait son peintre officiel et l'a même élevé à la dignité de chef des peintres de son palais. Le brave souverain ne devait certainement pas se douter que son protégé le représenterait ainsi telle une esquisse fantomatique à peine reconnaissable dans cette salle qu'il a faite édifier. Il devait sûrement s'attendre à être croqué le torse bombé, le regard conquérant, les pointes de sa moustache fièrement dressées avec en fond de toile sa Galerie des Miroirs étincelant de mille reflets miroitants. Comment a t-il perçu le tableau ? Quels commentaires en a t-il faits ? A t-il senti l'ironie, le regard acerbe du peintre derrière ses coups de pinceaux ?
L'artiste, bien que s'étant vu décerner par le souverain le titre pompeux de Kamal ol-Molk (la Perfection du Royaume) est un génie bien trop grand, libre et profond pour se laisser enfermer dans la flagornerie. Ce qu'il veut peindre avant tout, ce sont les remous de l'âme humaine, la vie secrète des coeurs, le sens derrière les apparences, les silences qui en disent long.
La force de ce tableau réside dans la possibilité que le peintre iranien a accordé à tout individu de s'identifier au sort du roi de Perse. Celui-ci, tournant le dos à son univers familier, à son apparat et à son opulence, laisse son regard se perdre dans le lointain, en dehors des murs de son palais, comme un homme qui aspire à la liberté, à l'évasion, à changer de vie, pour devenir peut-être un citoyen ordinaire ou un anachorète vivant sans souci du lendemain et tirant sa maigre pitance de la générosité des âmes charitables. Vu sous cet angle, le faste de la Galerie des Miroirs se révèle alors à nous dans toute sa signification véritable. La salle n'a de merveilleux que son apparence, sa surface. La réalité est que c'est une prison dorée dont les barreaux sont constitués de devoirs, de responsabilités, de mondanités, d'étiquette qui maintiennent le souverain sous bonne garde et lui rendent toute tentative d'évasion impossible.
Comme on est en terre perse, le soufisme et le derviche ne sont jamais bien loin. Kamal ol-Molk affirmait "qu'aucune grande oeuvre n'est possible sans grande pensée." Au vu de ce qui l'on vient de dire plus haut, on peut vraisemblablement interpréter ce tableau comme une illustration de ce leitmotiv inlassablement rappelé par les soufis qui voyaient dans la vie de ce monde avec son quotidien routinier et ses innombrables tentations, plus séduisantes les unes que les autres et aussi nombreuses que les gouttes dans l'océan ou que les images reflétées à l'infini dans des miroirs, des chimères qui retiennent l'âme humaine prisonnière dans un écheveau inextricable d'illusions où tout n'est que plaisirs trompeurs, vanité et poursuite de vent.
A travers la silhouette pathétique du Shah tournant le dos aux éclats scintillants des miroirs et à leurs images insaisissables pour porter son regard vers la campagne lumineuse, c'est l'émouvante condition d'une âme prise dans des rets, en proie à la mélancolie, et se languissant pour sa patrie spirituelle que le grand peintre persan nous donne à voir avec cette oeuvre. C'est par cette dimension ontologique que ce tableau se hisse au rang de chef-d'oeuvre de la peinture iranienne, pour ne pas dire mondiale.
 |
| Kamal ol-Molk |
 |
| La Galerie des miroirs, Palais de Golestan, Téhéran |
 |
| Galerie des Miroirs, Palais du Golestan, Téhéran |














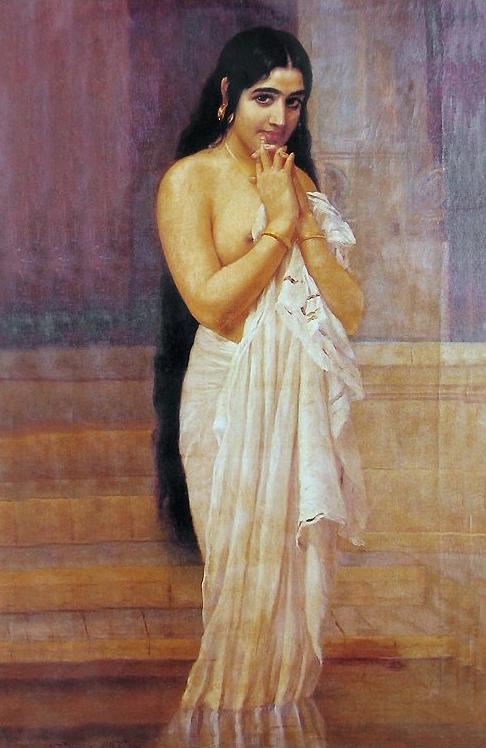



.jpg)












